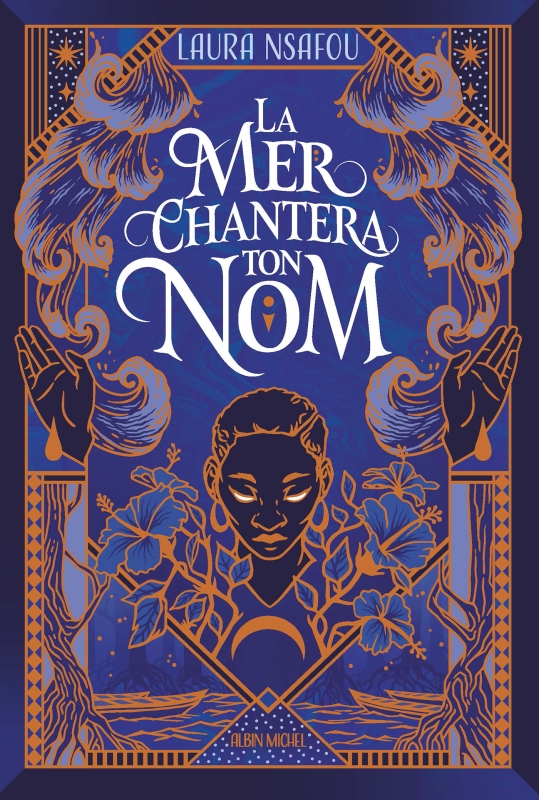Analyse de La mer chantera ton nom : une belle plume mais une question me taraude ?
J’ai enfin terminé La mer chantera ton nom (la vie de maman, vous connaissez), ce livre est très bien écrit. La plume de l’autrice est fluide, immersive, et agréable. Elle excelle particulièrement dans les descriptions graphiques et les scènes d’action, surtout celles qui touchent au monde invisible. On se laisse vraiment porter par son style, et c’est un véritable plaisir de lecture.
Mais vous le savez, rien n’est parfait dans ce monde. Et je me permets de donner mon avis, que j’espère juste, en tant qu’autrice et amoureuse d’heroic fantasy en tout genre !
Rentrons dans le vif du sujet !
Côté personnages, j’ai eu un peu de mal à m’attacher aux protagonistes. Ce n’est pas qu’ils soient mal construits ou inconsistants, je n’ai juste pas accroché à leurs personnalités, c’est tout. Mais au moins leurs choix et leurs décisions restent néanmoins cohérents avec l’intrigue.
Un point qui m’a un peu fait grincer des dents, c’est la romance. Cependant, soyons honnêtes, je ne suis pas le meilleur public pour les histoires romantiques. J’ai un cœur de pierre ! Je n’ai pas pleuré devant le Titanic ni devant Bambi.
En général, je trouve que les romances manquent de naturel et tombent souvent dans le « niais ». Je crois que je préfère les classiques, vieux jeu, à l’ancienne, où l’on est souvent dans la passion ultime avec des enjeux socio-culturels puissants. On y ressent l’amour avec un grand A. Anne Shirley et Gilbert Blythe ? Non ? Franchement, je voulais trouver mon Gilbert à la fin, moi ! Si on parle série, même Dr Quinn et Sully, c’était le feu. Pourtant, rien d’extraordinaire, mais ils ont pris le temps de « grandir » ensemble. Souvent, l’intérêt amoureux est là dès le début, mais la relation se construit en subtilité, avec du temps, des regards fuyants, des taquineries, des jalousies sourdes, des sacrifices… Bref, vous voyez !
Et vous savez quoi ? Il y a un peu de cela dans ce livre, mais ça ne fonctionne pas vraiment à mon goût. Tout va trop vite pour le genre de décisions qu’ils finissent par prendre. Le triangle amoureux aussi n’avait pas sa place. Le lieutenant est trop… « inexistant » dans la vie quotidienne d’Ino, malgré sa présence récurrente dans le récit, pour qu’on comprenne les sentiments qu’ils développent. Instant lust, peut-être, pas instant love.
Une mythologie déconnectée du cadre sénégalais
Dès les premières pages, une impression s’est imposée à moi : l’autrice n’est pas sénégalaise ou, du moins, elle n’a pas grandi dans cette culture. Bien entendu, je ne prétends pas tout connaître du Sénégal, mais je suis tombée dans la marmite quand j’étais petite, étant française d’origine sénégalaise. Cela m’a semblé évident en lisant certaines interactions avec les personnages, et j’ai noté quelques erreurs culturelles mineures (ça n’a pas gâché le récit, donc ça passe).
Ici, on nous présente des divinités africaines, des esprits, des djinns. Le premier problème vient du manque d’histoires et de légendes associées à ces dieux (leur genèse, en gros). Pourquoi Zeus et Thor nous marquent-ils ? Parce que nous connaissons leurs exploits et leurs mythes. Ici, les divinités sont nommées, mais sans réelle introduction, ce qui empêche de les rendre inoubliables.
Ensuite, le choix du Sénégal comme cadre pour une mythologie qui ne lui appartient pas pose question. Le pays a ses propres croyances, avec une forte influence de l’animisme et de l’islam. Il y a des marabouts, des guérisseurs, des « teneurs de pluie », des sorcières etc. Dans le village de mes parents, il y a carrément un quartier dédié aux sciences occultes où l’on retrouve des trucs étranges la nuit, vraiment… vous n’êtes pas prêts !
Ex. Un jour, on regardait Harry Potter (oui, je suis fan, je ne vais pas vous lâcher avec ça), et il y a la scène où Harry et Ron arrivent en retard, puis McGonagall se transforme de chat en humain. Mon père a balancé : « Ah, les blancs savent faire ça aussi ? »
Il y a vraiment de quoi faire.
Ino, le personnage principal, est la seule qui correspond au folklore sénégalais, vu qu’on apprend que c’est une deum. Elle a été réinterprétée, mais au moins on y est.
Mélanger des dieux, des esprits, d’origines diverses dans un cadre sénégalais crée une incohérence selon moi. Par exemple, si j’écrivais un roman sur les yōkai japonais, est-ce que j’introduirais des divinités hindoues ou chinoises ? Probablement pas. En tout cas, pas si ma volonté est de faire connaitre et d’introduire une mythologie inconnue à d’autres. Ce type de mélange peut être intéressant, mais pour moi, il ne marche que si on est déjà familier avec l’univers.
Ce point nous amène à une réflexion plus large sur la manière dont nous, en tant que communauté noire, réagissons à la représentation de nos cultures. Si nous dénonçons, par exemple, le « white-washing » et la réduction de l’Afrique à une entité uniforme, il est essentiel que nous ne reproduisions pas cette même logique, même de manière non intentionnelle, dans nos propres récits. La confusion ressentie par certains lecteurs, comme l’exprime un commentaire trouvé sur Babelio, démontre cette incompréhension : « Cette mythologie sénégalaise (je n’ose pas dire “africaine”, tant il y a de peuples et traditions différentes sur ce grand continent) me paraît floue. »
Si l’objectif est de présenter une mythologie sénégalaise, pourquoi mélanger des croyances d’autres cultures sans explication logique ? Si on a une cohérence lorsqu’on se retrouve au Congo à un moment dans le récit, je me questionne sur le choix du Sénégal pour le reste.
Dans ce cas précis, l’autrice aurait peut-être gagné à choisir une mythologie spécifique, liée à un lieu spécifique, avec ses propres dieux, légendes et récits, ou bien carrément inventer un univers, un autre monde inconnu, qui aurait permis de traiter cette question de manière plus cohérente.
Conclusion
La mer chantera ton nom reste un roman bien écrit, avec un rythme entraînant et une imagination foisonnante. Mais le traitement des divinités et du folklore aurait gagné à être mieux introduit et mieux documenté.
Après, un livre de fantasy peut-il tout mélanger sans explication ? Bien sûr. Mais un univers réussi repose sur une cohérence interne et une véritable immersion culturelle. C’est ce qui fait la richesse des mythologies nordiques, grecques ou japonaises dans la littérature. Pour que les divinités africaines marquent les esprits de la même manière, elles doivent avoir leurs légendes, leurs récits, et un cadre qui leur rend justice. Et, peut-être, un peu plus de clarté pour nous, les lecteurs.
Comme j’aime les explications, voici des informations sur quelques divinités et esprits qu’on retrouve dans ce livre :
- Deum :
- Origine : Sénégal
Ce sont des êtres maléfiques de la tradition Wolof, parfois associés aux Djinns. Mais ça peut aussi correspondre à des sorciers ou sorcières selon l’endroit où l’on se trouve au Sénégal. Ils ont la réputation de « manger des âmes ». Ils peuvent posséder les corps humains. On peut aussi leur demander des faveurs, mais avec un sacrifice en contrepartie.
- Origine : Sénégal
- Guddi :
- Veut dire « Nuit » en Wolof. Mais ce n’est pas une divinité. Il est présenté dans l’ouvrage comme le Dieu créateur de la nuit.
- Iemanja :
- Origine : Nigéria
Iemanjá (ou Yemọja, Yemoja) est une divinité d’origine yoruba, vénérée dans plusieurs traditions afro-descendantes, notamment au Brésil (candomblé, umbanda), à Cuba (santería) et dans d’autres parties des Amériques. C’est l’orisha (divinité) de la mer, des eaux et de la maternité. Elle est souvent représentée comme une femme majestueuse, parfois avec une queue de poisson, associée à la protection des pêcheurs, des marins et des mères. Son culte est encore très vivant, notamment au Brésil, où des festivités lui sont dédiées, avec des offrandes jetées à la mer.
- Origine : Nigéria
- Umdhlebis :
- Origine : Afrique du Sud
Ce serait un arbre mythique et maléfique, évoqué dans certaines traditions zouloues. Il est décrit comme une plante toxique capable de tuer tout être vivant à proximité en émettant une sorte de poison ou de gaz mortel.
- Origine : Afrique du Sud
- Djinns :
Bon ça, on connaît, ce sont des esprits malins, issus des folklores et légendes musulmanes surtout. - Adroa :
- Origine : Afrique de l’Est, Ouganda, Congo
C’est une divinité du peuple Lugbara, une ethnie d’Afrique de l’Est, principalement en Ouganda et en République Démocratique du Congo. Dans la mythologie lugbara, Adroa est un dieu dual, représentant à la fois le bien et le mal. Il est souvent décrit comme ayant un corps divisé en deux : une moitié visible et bienveillante, et une moitié invisible et malveillante. Cette dualité symbolise l’équilibre entre les forces opposées dans l’univers.
- Origine : Afrique de l’Est, Ouganda, Congo
- Bunzi :
- Origine : Congo
Egalement connue sous les noms de Mpulu Bunzi et Phulu Bunzi, est une divinité serpentine de l’eau et une déesse de la pluie dans la religion traditionnelle Kongo. Elle a d’abord été vénérée par le peuple Woyo du royaume de Ngoyo. Cette figure mythologique incarne l’élément de l’eau, de la pluie et de la fertilité, associée à des pouvoirs de récoltes abondantes pour ceux qui l’honorent.
- Origine : Congo
- Xevioso :
- Origine : Togo, Bénin
C’est une figure mythologique appartenant aux traditions religieuses et culturelles des peuples du Togo et du Bénin, plus spécifiquement du peuple Fon. Xevioso est le dieu du tonnerre et des éclairs. Il est associé à la fois au mal et au bien, selon les contextes, et est souvent appelé à intervenir pour protéger ses adeptes contre les mauvaises actions.
- Origine : Togo, Bénin
Children of Blood and Bone VS La mer chantera ton nom
Si Children of Blood and Bone a captivé l’attention de nombreux lecteurs, je ne l’ai pas du tout aimé. Vous avez tout un article dessus sur le site !
La mer chantera ton nom de Laura N’safou propose une approche plus réfléchie, où l’univers et les personnages sont bien mieux construits.
Voici pourquoi La mer chantera ton nom est mieux réussi et original :
- Une construction d’univers plus réfléchie
L’univers de La mer chantera ton nom repose sur une mythologie africaine, avec un décor sénégalais, et l’approche du mystique dépasse un simple ancrage local. L’autrice construit un monde réfléchi et immersif, où l’invisible et le surnaturel occupent une place prépondérante. Contrairement à Children of Blood and Bone, où la mythologie… eh bien, il n’y en a pas vraiment… on jette deux ou trois divinités, mais pourquoi, comment, à quoi servent-elles ? Je cherche encore.
Là où Children of Blood and Bone offre un système de magie quasi inexistant, La mer chantera ton nom maîtrise mieux la magie et les rituels, qui sont plus souvent expliqués, même si certains aspects, notamment liés aux pouvoirs d’Ino, restent flous. - Des personnages plus solides et nuancés
Je disais plus tôt que je ne m’étais pas attachée aux personnages de La mer chantera ton nom (peut-être parce que je suis vieille, who knows, ça reste de la YA), mais ils avaient le mérite d’avoir des personnalités distinctes. C’est ce qui a cruellement manqué dans le livre de Tomi Adeyemi, où les personnages (hormis les méchants… parce qu’ils sont méchants) étaient facilement interchangeables tellement ils étaient insipides, avec des personnalités neutres et sans saveur. - Une narration plus fluide
L’un des points forts de La mer chantera ton nom réside dans la manière dont l’autrice prend le temps de construire son univers et de détailler les scènes pour leur donner du sens par la suite. On peut penser que le démarrage est long, mais moi, ça ne me dérange pas (j’ai mangé du Tolkien, je peux survivre à tout). Elle contraste avec la narration plus précipitée de Children of Blood and Bone, où il n’y a qu’une succession d’événements pour aller d’un point A à un point B. Comme dans je ne sais plus quel épisode de South Park, qui dénonce la manière d’écrire d’aujourd’hui : « Then and then and then… (Puis et puis et puis…) », au lieu de « This happened, therefore… (Cela s’est produit, et en conséquence…) »
En conclusion, malgré mon étonnement—ou peut-être ma déception initiale—où je pensais plonger au cœur des croyances de mon pays d’origine, La mer chantera ton nom s’impose comme un roman bien plus abouti en termes de construction, de fluidité et de cohérence. Laura N’safou propose une œuvre travaillée, où chaque élément—mythologie, magie, relations entre les personnages—s’imbrique avec justesse (exit la romance, mais ça, c’est mon problème !). Son livre prouve qu’il est possible d’écrire une fantasy inspirée des cultures africaines sans tomber dans la superficialité ni se contenter d’un simple vernis exotique. Ses scènes sont si vivantes que je pouvais facilement les imaginer dans ma tête. À quand l’adaptation cinématographique ? Je rêve sûrement, mais après tout, ce serait une belle occasion de prouver que les Français savent aussi y faire. Marre des scénarios prémâchés hollywoodiens.