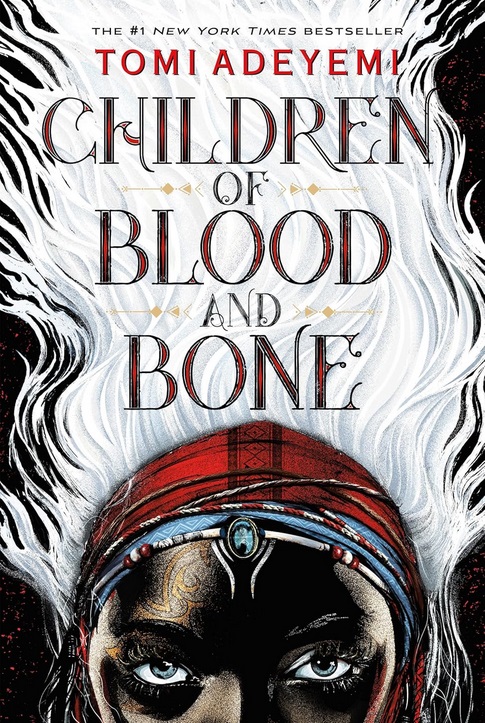Les pensées d’Adama : Et si on parlait de Children of Blood and Bone ?
Tout d’abord, je ne vais citer que le titre en anglais parce que je l’ai lu en anglais, donc le titre français ne me parle pas.
Quand on m’a recommandé Children of Blood and Bone de Tomi Adeyemi, c’était avec ces mots :
“C’est comme Harry Potter, mais pour les personnes noires.”
Autant dire que cette comparaison m’a immédiatement mise mal à l’aise. Non seulement parce qu’elle réduit l’ouvrage à une simple copie d’une œuvre occidentale, mais aussi parce qu’elle trahit une tendance agaçante à enrober la littérature écrite par des personnes noires dans des références mainstream pour la rendre plus “acceptable” ou “accessible”.
Je comprends bien sûr l’angle marketing derrière cette comparaison. Harry Potter est une référence universelle, un point de ralliement qui promet un succès commercial. C’est rassurant pour les éditeurs et les lecteurs qui cherchent un terrain familier. Mais est-ce vraiment nécessaire ? Si l’histoire est bonne — et Children of Blood and Bone avait beaucoup d’arguments pour l’être — pourquoi ne pas laisser les lecteurs décider eux-mêmes de la labelliser ? Pourquoi ne pas la laisser exister comme un classique potentiel, sans ce besoin de l’adosser à un géant de la fantasy occidentale ?
Bref, je cherchais de l’héroïque fantasy africaine, un univers qui me ferait voyager dans un imaginaire radicalement différent, qui célébrerait des récits et des esthétiques puisés dans nos traditions. Alors, pourquoi avait-on besoin de me vendre ce livre avec une comparaison aussi réductrice ?
Une lecture empreinte de déception
Je ne suis pas étrangère à l’héroïque fantasy ou à la science-fiction. Ce sont mes genres de prédilection, que ce soit en littérature ou au cinéma. Je pourrais passer des heures à débattre des subtilités narratives chez Tolkien, analyser les arcs des personnages dans Dragonriders of Pern d’Anne McCaffrey. J’ai bien sûr lu et adoré Harry Potter, mais j’ai aussi un faible pour l’humour absurde de The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy.
En tout cas, je pense avoir un bagage suffisant pour juger si une histoire tient la route dans ces genres, même si l’opinion reste toujours subjective. C’est peut-être pour ça que Children of Blood and Bone m’a laissée perplexe.
Je vais mettre ça en plusieurs points.
- Une pâle copie d’Avatar
Très vite, j’ai ressenti une impression dérangeante de déjà-vu. Le récit me rappelait beaucoup Avatar: Le dernier maître de l’air. Je ne parle pas ici d’une légère inspiration ou d’un clin d’œil respectueux — l’autrice elle-même a reconnu s’être inspirée de cet univers —, mais d’une ressemblance tellement marquée que certaines scènes semblaient presque calquées. Cela m’a sortie de l’histoire à plusieurs reprises.
Une œuvre peut s’inspirer, c’est naturel, mais quand les parallèles deviennent trop évidents, cela finit par éclipser ce qui aurait pu faire son originalité.
Des exemples concrets ?
- Zélie = Une étrange ressemblance à Katara. Elle a un frère qui la suit dans son aventure et une mère qui s’est fait tuer quand ils étaient jeunes, par leurs ennemis. Les deux villages (livre et dessin animé) sont brûlés.
- Inan = Zuko. Les deux sont des princes, leur père est un tyran et ils veulent prouver leur valeur en tuant le personnage principal.
- Tzain = Sokka. Le frère de Zélie. Le protecteur. La seule différence, c’est que Tzain est ennuyeux à en crever.
- King Saran = Lord Ozai. Le roi psychopathe.
- Nalhia (Lionnaire) = Appa (le bison volant). L’animal géant qui les sort in extremis de la catastrophe.
- Amari = La sœur de Tzain. Ce n’est pas une tarée comme Azula (d’ailleurs, il y a un équivalent d’Azula = Kaea), mais, tiens donc, elle a une cicatrice ! Sauf que cette fois, le défi, ce n’était pas le père et le fils, mais la sœur (Amari) et le frère (Tzain). C’est Tzain qui la marque à jamais, dans une scène quasiment similaire à celle de l’anime.
Bref, on prend tous les personnages, on remix un peu et ça donne les personnages de Children of Blood and Bone. La liste des similitudes est longue… très longue.
- Une romance nulle à se taper la tête contre un mur
Vous savez quoi ? Je ne vais même pas m’étaler sur la question. Est-ce qu’on peut appeler ça une romance ?
C’est forcé, inconfortable, incohérent…
La seule pensée qui m’a traversé l’esprit, c’est que l’autrice n’est probablement jamais tombée amoureuse. Même les souvenirs de mon crush de classe de 5e sont plus excitants… alors que je m’en tape comme ma première paire de chaussettes.
- Un Lore à deux francs six sous
Là, j’ai de quoi dire !
J’ai lu des commentaires me parlant d’un univers hyper bien construit et d’un système de magie de folie. Il semblerait qu’on n’ait pas lu la même histoire…
Tout dans la communication autour du livre, des critiques aux quatrièmes de couverture, semblait promettre une plongée immersive dans des traditions et un folklore rarement explorés en héroïque fantasy. Mais à la lecture, j’ai ressenti une grande frustration : cette richesse culturelle promise n’est présente qu’en surface.
Certes, il y a des clins d’œil — des noms yorubas, quelques références aux Orishas — mais cela ne va jamais plus loin. Le décor semble parfois réduit à un arrière-plan vaguement « exotique », sur lequel on a simplement appliqué une fine couche de peinture africaine.
Le problème n’est pas que l’autrice s’inspire de la mythologie ouest-africaine ou de récits existants — après tout, la plupart des grandes œuvres fantastiques puisent dans des mythes ou des légendes bien établis. Ce qui fait la différence, c’est la capacité d’un auteur à réinventer ces éléments, à les sublimer et à leur donner une nouvelle profondeur qui enrichit l’univers et captive le lecteur.
J.K. Rowling, par exemple, a puisé dans des mythes grecs et européens, mais elle a réussi à transformer ces inspirations en créatures inoubliables comme les hippogriffes, les Sombrals ou les basilics. Tolkien, avec les Oliphants ou même les Ents, en est un autre exemple. Il s’est inspiré d’éléments de mythologies et de récits anciens, mais il les a transformés en entités qui ont une véritable profondeur et une place intégrée dans son univers. Ce n’est pas seulement une question d’inventer une créature cool, mais de la rendre crédible, symbolique et indispensable à l’histoire.
C’est là où Children of Blood and Bone rate une opportunité. L’idée de s’inspirer de la mythologie ouest-africaine est géniale, surtout quand on sait à quel point elle regorge d’histoires puissantes et de créatures fascinantes. On aurait pu imaginer des références aux Ninki Nanka, aux esprits des eaux comme les Mami Wata, ou même des interprétations modernes des créatures présentes dans les contes animistes. Ces inspirations, bien détournées et réinventées, auraient pu enrichir l’univers et le rendre unique.
Au lieu de ça, on se retrouve avec des lions et des panthères géants, qui manquent d’originalité et de contexte.
Et la nourriture, parlons-en !
Il y en a qui s’en fichent, mais pour moi, c’est un bon moyen d’introduire une culture.
La cuisine est un vecteur culturel puissant, un lien direct avec l’histoire, les traditions et même les émotions d’un peuple. Pourtant, dans Children of Blood and Bone, la nourriture semble introduite de manière artificielle, presque comme une obligation de « coche culturelle ». Par exemple, à un moment, l’héroïne évoque « l’odeur des plantains qui lui rappelait sa mère ». Ce genre de détail, au lieu d’ajouter de la richesse au récit, tombe à plat parce qu’il manque de contexte et de subtilité.
Puis… les plantains quoi ? Il n’y a pas de plat nigérian plus intéressant ? Pourquoi ne pas créer des plats mystiques liés à la magie des Orishas ? Ou des ingrédients spécifiques à ce monde imaginaire ?
Et le système de magie ?
C’est simple, y’en a pas.
On me balance des divinités clairsemées à gauche à droite, des formules magiques aussi longues que le Silmarillion, dans une langue africaine, donc impossible à retenir. On ne sait pas comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, et quand il y a des explications (très peu), on est encore plus confus.
Conclusion
J’imagine que les seules personnes qui ont apprécié ce livre n’ont jamais lu de fantasy et n’ont jamais vu Avatar. Grand bien leur en fasse, ça leur a évité d’avoir l’impression de mourir d’une mort lente et tortueuse.
Alors oui, je balance ici tout mon venin, parce que nous devons faire mieux. Je refuse qu’on nous dise que ce livre est un classique de la fantasy africaine. Ça voudrait dire qu’on (nous, les Noirs) ne sait pas faire aussi bien ou mieux que les autres.
Mais bonne nouvelle ! Il y a des livres beaucoup moins hype qui en valent la peine :
- The Kishi (Antoine Bandele)
- Who Fears Death (Nnedi Okorafor)
- Nameless Republic (Suyi Davis Okungbowa)
Pour les références françaises, je ferai un autre article avec un Focus sur « La mer chantera ton nom » (Laura N’safou)
Point bonus :
Un film qui devra faire mieux, beaucoup mieux !
Il y a quelques jours, le casting du film a été révélé avec des noms à faire tourner la tête : Viola Davis, Idris Elba, Cynthia Erivo, Regina King…
Je n’entre pas dans la polémique du casting, où l’on aurait préféré des acteurs nigérians vu l’histoire.
Mais encore une fois, ce casting me fait tout simplement dire : on ne fait tellement pas confiance au succès de ce film qu’on vous met toutes les têtes d’affiche, comme ça, on est sûrs de rentrer dans nos frais.
De mon côté, j’y vois l’opportunité d’apporter plus de profondeur à l’histoire et aux personnages, plus de logique, et de créer un bel univers esthétique… pour enfin pouvoir avoir un cosplay qui me ressemble au Comic-Con de Paris.
Plus sérieusement, ils peuvent faire en sorte que le film entre dans ce cercle très fermé des adaptations cinématographiques qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que le livre.
Rendez-vous en janvier 2027 !